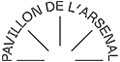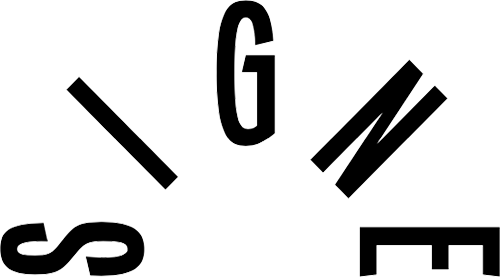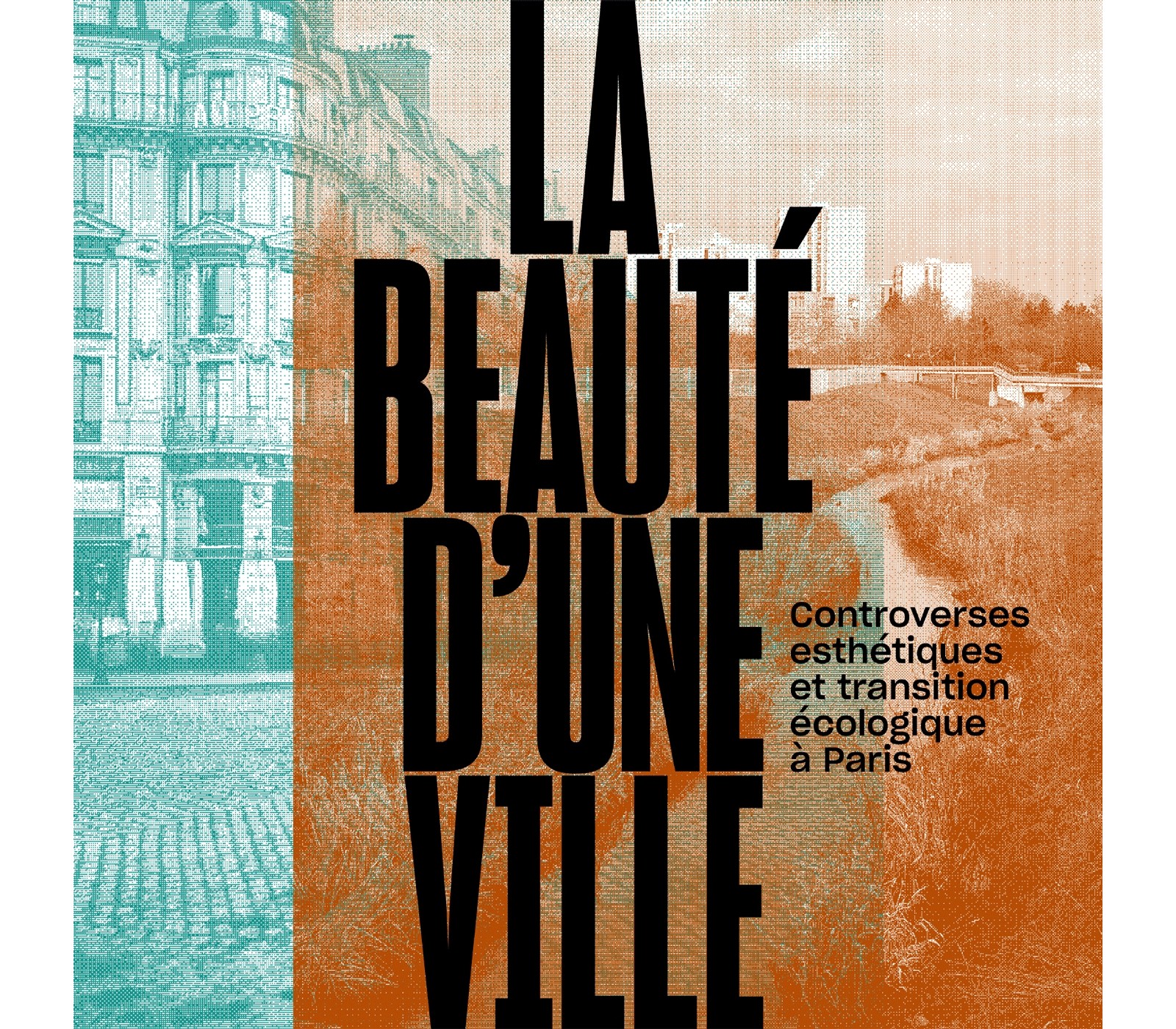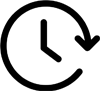Le mot « réparer » figurait en capitales sur la couverture du dernier numéro de Noël de Télérama. Il posait ainsi une question à laquelle il nous faut répondre : celle du réemploi des bâtiments existants comme de leurs matériaux. Télérama avait déjà anticipé les manifestations des Gilets jaunes avec son article sur « la France moche », celles des ronds-points, des supermarchés, des zones pavillonnaires[1]. C’est aussi celle qu’il nous faut aujourd’hui réparer, c’est-à-dire parer à nouveau pour donner forme à l’informe, le transformer en quelque sorte, par un préfixe, « trans- », somme toute métaphysique.
L’architecture, comme art de la transformation du monde[2], des situations, des programmes et des choses enfin, ne peut être définie par la seule référence à l’ineffable du beau, qui sous-tendait l’enseignement de l’École des beaux-arts. Ses maîtres avaient oublié les leçons du rationalisme de J.-N.-L. Durand, ou de celui construit par Eugène Viollet-le-Duc et ses épigones. Certes, l’architecture est un art, mais au sens que l’on donne à ce mot dans « arts et métiers ». Elle est donc tout autant une technique.
L’architecture implique ainsi la question de la matérialité comme champ culturel. Cette attitude dépasse l’antique opposition de l’âme et du corps, de la matière (forcément mal dégrossie) et de l’esprit. Tel est le point de vue développé par les sociologues et historiens de l’art anglo-saxons, et ceux de l’École de Francfort. Le parti pris des choses comme le bris-collage, qui doivent tout autant à Francis Ponge qu’à Claude Lévi-Strauss, en transportent la trace dans les bâtiments, ceux que nous construisons, comme ceux que nous réparons.
De façon plus radicale, Bruno Latour, dans ses récentes interventions, pose la question préalable de la réparation de la Terre, condition nécessaire à toute vie humaine[3]. La déforestation, les néonicotinoïdes, les émissions de CO2, le plastique dans les océans ne sont que quelques exemples de ce que nous devons stopper dans une progression qui met en cause la vie de l’être humain sur notre planète. On pourrait s’arrêter à ce constat, mais cette prise de position globale est la condition nécessaire à la migration des humains d’un monde qui fut agricole vers un monde qui devient urbain.
Réparons donc.