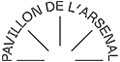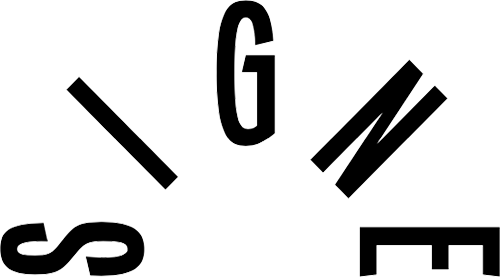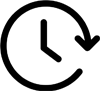Dans son dernier ouvrage, Anselm Jappe déploie une histoire critique de la valeur du matériau béton. De sa genèse à son expansion mondialisée jusqu'à son hégémonie, il questionne les desseins de ses très nombreux zélateurs, des forces populaires prolétaires aux capitalistes internationaux. Il interroge aussi les effets de ce matériau qui assèche les territoires et détruit les milieux qu'il colonise. Dès lors, peut-on guérir de la bétonnite ? Et comment ? C'est tout l'enjeu de cet article qui, en interrogeant la matière, questionne nos modèles de fabrication des villes.
L’écho qu’a trouvé mon livre Béton. Arme de construction massive du capitalisme (L’Échappée, 2020) a fini par me surprendre moi-même. Naturellement, depuis ma jeunesse, j’ai entendu des plaintes sur les « tristes cités en béton », sur ce béton toujours associé au « gris ». Mais, par comparaison avec le nucléaire et le pétrole, avec le plastique et les pesticides, le béton gardait un air presque « innocent ». Il était, disait-on, mal utilisé plus que coupable dans sa nature intime. Peu à peu, même les plus « progressistes » ont dû admettre qu’il ne peut pas y avoir d’usage « communiste » du nucléaire, ni de « révolution verte » dans les pays pauvres à coups de pesticides sans tuer, avec les parasites, le reste du vivant. Le béton, en revanche, a continué longtemps à passer pour un matériel dont il importait essentiellement de faire un emploi modéré et approprié (et de le peindre en couleurs). Faire assumer au seul béton – en tant que matériau – le « caractère non hospitalier de nos villes » (Alexander Mitscherlich) et, surtout, de nos banlieues aurait semblé tout aussi incohérent qu’expliquer la guerre par l’existence du fer.
Pourtant, de nombreux griefs contre le béton se sont accumulés au cours des dernières décennies et semblent prêts maintenant à se manifester au grand jour. Certains relèvent du constat scientifique et sont indéniables : le béton n’est pas « neutre » sur le plan écologique et sanitaire. Sa production consomme beaucoup d’énergie et émet de grosses quantités de CO2. L’extraction de calcaire endommage les montagnes. Le besoin de masses gigantesques de sable entraîne une dévastation des rivières, plages et lacs dans de nombreux endroits du monde, avec leur suite de conséquences sur l’environnement et la vie des habitants. La poussière de béton peut causer des maladies respiratoires, et les sols en béton des soucis de posture. Les déchets sont en théorie recyclables mais, en raison du coût élevé de cette opération, ils sont fréquemment abandonnés n’importe où. Dans les villes en béton se forment des îlots de chaleur qui, combinés à la pollution de l’air, détériorent la santé des habitants et imposent l’usage d’une autre source de pollution : la climatisation. La bétonnisation des sols, qui progresse partout à un rythme impressionnant, suffoque les terrains et occasionne des alluvions graves, voire catastrophiques lors de fortes pluies.
Ceux-là sont des inconvénients « techniques », auxquels on propose souvent, assez paradoxalement, de remédier par d’autres solutions technologiques ou par des contraintes légales renforcées. Un peu plus de taxes sur le charbon, quelques aides d’État pour rendre plus convenable le recyclage… L’essentiel est-il là ?
Dans mon livre, j’évoque un autre niveau de la question, qui prête, sans doute, davantage à discussion. Le béton, s’il est « armé », combiné à l’acier, a une espérance de vie autour de cinquante ans ; au-delà de cette durée, il faut une maintenance permanente et coûteuse qui peut aussi faire défaut – comme dans le cas du pont Morandi à Gênes. Cependant, cette vie courte peut encore être tenue pour un avantage, à l’instar de toute forme d’obsolescence programmée : elle permet de renouveler en permanence le bâti, faisant ainsi tourner l’économie, ce qui crée des emplois, des revenus et de la croissance – et évite l’ennui de devoir vivre avec des bâtiments d’il y a cinquante ans, aussi dépassés qu’un portable de l’année dernière. La « destruction créatrice » incessante est l’âme du capitalisme, nous le savons depuis Joseph Schumpeter. Elle n’est cependant pas toujours très bonne pour l’écologie, ni pour les finances publiques – mais, dans la mesure où elle permet de sauver le dieu fétiche de la croissance année après année, cette forme de religion économique continue à avoir ses théologiens et ses pratiquants.
Le discours est pourtant plus vaste. On peut reprocher au béton ce qui, selon d’autres, constitue au contraire son mérite le plus grand : avoir rendu possible l’architecture du xxe siècle. Ni les plus importants barrages, ponts, autoroutes, centrales nucléaires et gratte-ciel, ni les bidonvilles du monde entier, ni les « chefs-d’œuvre » des architectes les plus célèbres, ni les pavillons et « tours » de banlieue n’existeraient sans le béton. La droite et la gauche, les communistes, les fascistes et les démocrates y ont eu recours. Le béton se trouve au cœur de l’un descore business du capitalisme mondial – la construction – et s’est souvent vu célébré par les forces anticapitalistes comme un matériau « populaire » ou « prolétaire ».