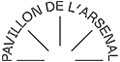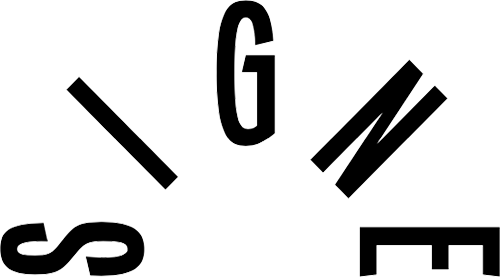Les architectes ont-ils quelque chose à dire (et à faire) en cette période de grand confinement ? Après tout, ils ne sont pas sur la ligne de front de la lutte contre le covid-19 et quand bien même le monde entier serait en guerre, ils ne vont pas non plus être amenés à imaginer comment reconstruire ce qui n’est même pas en train d’être démoli. Leur possible « aura » de (re)constructeurs s’effacera sans doute derrière celle des soignants qui, comme l’a rappelé Emmanuel Macron, ont désormais « des droits sur nous ». Pourtant, si le coronavirus n’appelle le dessin d’aucun nouveau monde, il n’en est pas moins le révélateur de certaines carences, fonctionnelles ou anthropologiques, dont les architectes auraient tout intérêt à se saisir. J’en perçois au moins deux.
La première relève de l’organisation matérielle de nos sociétés. Dans un entretien récent paru dans Le Monde du 9 avril, la philosophe Barbara Stiegler attribuait l’impréparation à la crise sanitaire à un aspect particulier du modèle néo-libéral : le privilège du flux sur le stock. « Moins il y a de lits, de matériels, de médicaments, de personnels, plus il y a d’agilité, d’innovation de dépassement, d’adaptation et cela est considéré comme moteur de progrès, » a-t-elle rappelé. « C’est avec cette injonction que s’est faite la gestion de l’hôpital. Sauf qu’à flux tendu il est impossible de faire face à l’imprévu. » Parmi les leçons à tirer de l’actuelle pandémie, celle-ci me paraît d’importance : sans stock, il n'y a pas de résilience possible.
Avant le confinement déjà, la tension était latente entre, d’un côté, le surcroît de nomadisme offert par le numérique, les voyages low-cost et la financiarisation de l’immobilier et, de l’autre, la névrose sédentaire que trahissait le succès prodigieux des sites de « self-stockage » – notamment du à l’insuffisance de rangements dans nos logements – et les obsessions de sauvegarde qui obligeaient les data-centers à augmenter sans cesse leurs capacités. En accentuant cette névrose sédentaire, le confinement a exacerbé cette tension. Le mirage d’une ville sous flux tendus permanents ne parvient désormais plus à masquer la nécessité des réserves qui s’accroît à tous les niveaux de la société, du plus individuel au plus mondial.
Il est donc vraisemblable qu’au terme de cette crise, l’architecture du stock, longtemps méprisée, dévalorisée, réservée aux classes sociales inférieures et sédentaires, soit amenée à acquérir une valeur à la fois marchande et symbolique. Les greniers, ces maisons d’abondance, qui suscitaient, dans les sociétés traditionnelles, la fierté collective, la foi dans l’avenir, et la convoitise – jusqu’à susciter des guerres – pourraient redevenir le seul remède à l’angoisse qui monte lorsque l’on a les yeux rivés sur les dépenses et que les réserves ont disparu du champ de vision. Les entrepôts se transformeraient en monuments, ringardisant définitivement les monuments du flux qu’étaient les gares, les routes et les aéroports, tandis que dans les logements – qui n’ont pas attendu le télétravail forcé pour devenir des lieux également dédiés à l’exercice professionnel –, les rangements ré-occuperaient une place centrale, contribuant tout à la fois à conjurer les menaces, réduire les consommations et assurer le lien perdu entre les générations.
J’en viens à la deuxième carence révélée par la crise sanitaire du coronavirus. Dans un entretien récent à Mediapart (12 avril 2020), l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau, se disait sidéré « par l’acceptation, sans beaucoup de protestations, des modalités d’accompagnement des mourants du covid-19 dans les Ehpad » et allait jusqu’à considérer l’interdiction d’accompagner les morts jusqu’à leurs dernières demeures comme « une transgression anthropologique majeure qui s’est produite quasiment toute seule ». Je me permets d’avancer ici une hypothèse pour expliquer ce qui a permis une telle infraction à une des obligations les plus fondamentales des sociétés humaines. Depuis un moment déjà, la mort a cessé d’être une question, si j’ose dire, matérielle. Il n’est qu’à considérer le désintérêt quasi-complet de nos contemporains pour l’architecture funéraire. Le silence de la tombe a laissé place à l’empathie. Les récits de vie, Wikipedia, se sont substitués à la pierre. Or poser une pierre sur un corps mis en terre c’est bien autre chose que prolonger sa vie par le récit. C’est convertir une absence en un lieu marqué par une pierre. Une pierre faite pour durer, bien au-delà des nécrologies qui inondent la littérature et le web.
« Artiste, fuis la lumière des cieux ! Descends dans les tombeaux pour y tracer les idées à la lueur pâle et mourante des lampes sépultrales ! » écrivait l’architecte Étienne-Louis Boullée en 1793. Le goût pour la transparence lumineuse qu’ont traduit les deux siècles qui viennent de s’écouler ont laissé dans l’ombre ce qui fut pourtant, dans l’histoire, une des grandes raisons de l’architecture : compenser la finitude du monde. Une raison qui est amenée à prendre de l’ampleur lorsque les lieux du travail se virtualisent et que l’habitat des vivants se déqualifie, au point, comme l’ont rappelé les architectes confinés François Leclercq, Jacques Lucan et Odile Seyler, de ne plus parvenir à compenser l’instabilité de la société contemporaine (Le Monde, 24 avril 2020). Pour ce faire, l’espace et l’ouverture, ces grandes valeurs de la modernité architecturale, ne peuvent suffire. Un besoin d’opacité se fait sentir, lequel n’est pas seulement celui d’une capacité de stockage au sein de la demeure des vivants, mais également la dignité de son pendant, à savoir la demeure des morts, seule à même d’assurer un lien entre le passé et l’avenir dès lors que les rites d’accompagnement, religieux ou non, sont susceptibles de s’effacer derrière des impératifs sanitaires.
Le grenier et la tombe. Voilà deux archétypes primitifs dont l’absence a surgi avec cruauté ces derniers jours et sur lesquels les architectes seraient bien inspirés de plancher dès à présent.
La première relève de l’organisation matérielle de nos sociétés. Dans un entretien récent paru dans Le Monde du 9 avril, la philosophe Barbara Stiegler attribuait l’impréparation à la crise sanitaire à un aspect particulier du modèle néo-libéral : le privilège du flux sur le stock. « Moins il y a de lits, de matériels, de médicaments, de personnels, plus il y a d’agilité, d’innovation de dépassement, d’adaptation et cela est considéré comme moteur de progrès, » a-t-elle rappelé. « C’est avec cette injonction que s’est faite la gestion de l’hôpital. Sauf qu’à flux tendu il est impossible de faire face à l’imprévu. » Parmi les leçons à tirer de l’actuelle pandémie, celle-ci me paraît d’importance : sans stock, il n'y a pas de résilience possible.
Avant le confinement déjà, la tension était latente entre, d’un côté, le surcroît de nomadisme offert par le numérique, les voyages low-cost et la financiarisation de l’immobilier et, de l’autre, la névrose sédentaire que trahissait le succès prodigieux des sites de « self-stockage » – notamment du à l’insuffisance de rangements dans nos logements – et les obsessions de sauvegarde qui obligeaient les data-centers à augmenter sans cesse leurs capacités. En accentuant cette névrose sédentaire, le confinement a exacerbé cette tension. Le mirage d’une ville sous flux tendus permanents ne parvient désormais plus à masquer la nécessité des réserves qui s’accroît à tous les niveaux de la société, du plus individuel au plus mondial.
Il est donc vraisemblable qu’au terme de cette crise, l’architecture du stock, longtemps méprisée, dévalorisée, réservée aux classes sociales inférieures et sédentaires, soit amenée à acquérir une valeur à la fois marchande et symbolique. Les greniers, ces maisons d’abondance, qui suscitaient, dans les sociétés traditionnelles, la fierté collective, la foi dans l’avenir, et la convoitise – jusqu’à susciter des guerres – pourraient redevenir le seul remède à l’angoisse qui monte lorsque l’on a les yeux rivés sur les dépenses et que les réserves ont disparu du champ de vision. Les entrepôts se transformeraient en monuments, ringardisant définitivement les monuments du flux qu’étaient les gares, les routes et les aéroports, tandis que dans les logements – qui n’ont pas attendu le télétravail forcé pour devenir des lieux également dédiés à l’exercice professionnel –, les rangements ré-occuperaient une place centrale, contribuant tout à la fois à conjurer les menaces, réduire les consommations et assurer le lien perdu entre les générations.
J’en viens à la deuxième carence révélée par la crise sanitaire du coronavirus. Dans un entretien récent à Mediapart (12 avril 2020), l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau, se disait sidéré « par l’acceptation, sans beaucoup de protestations, des modalités d’accompagnement des mourants du covid-19 dans les Ehpad » et allait jusqu’à considérer l’interdiction d’accompagner les morts jusqu’à leurs dernières demeures comme « une transgression anthropologique majeure qui s’est produite quasiment toute seule ». Je me permets d’avancer ici une hypothèse pour expliquer ce qui a permis une telle infraction à une des obligations les plus fondamentales des sociétés humaines. Depuis un moment déjà, la mort a cessé d’être une question, si j’ose dire, matérielle. Il n’est qu’à considérer le désintérêt quasi-complet de nos contemporains pour l’architecture funéraire. Le silence de la tombe a laissé place à l’empathie. Les récits de vie, Wikipedia, se sont substitués à la pierre. Or poser une pierre sur un corps mis en terre c’est bien autre chose que prolonger sa vie par le récit. C’est convertir une absence en un lieu marqué par une pierre. Une pierre faite pour durer, bien au-delà des nécrologies qui inondent la littérature et le web.
« Artiste, fuis la lumière des cieux ! Descends dans les tombeaux pour y tracer les idées à la lueur pâle et mourante des lampes sépultrales ! » écrivait l’architecte Étienne-Louis Boullée en 1793. Le goût pour la transparence lumineuse qu’ont traduit les deux siècles qui viennent de s’écouler ont laissé dans l’ombre ce qui fut pourtant, dans l’histoire, une des grandes raisons de l’architecture : compenser la finitude du monde. Une raison qui est amenée à prendre de l’ampleur lorsque les lieux du travail se virtualisent et que l’habitat des vivants se déqualifie, au point, comme l’ont rappelé les architectes confinés François Leclercq, Jacques Lucan et Odile Seyler, de ne plus parvenir à compenser l’instabilité de la société contemporaine (Le Monde, 24 avril 2020). Pour ce faire, l’espace et l’ouverture, ces grandes valeurs de la modernité architecturale, ne peuvent suffire. Un besoin d’opacité se fait sentir, lequel n’est pas seulement celui d’une capacité de stockage au sein de la demeure des vivants, mais également la dignité de son pendant, à savoir la demeure des morts, seule à même d’assurer un lien entre le passé et l’avenir dès lors que les rites d’accompagnement, religieux ou non, sont susceptibles de s’effacer derrière des impératifs sanitaires.
Le grenier et la tombe. Voilà deux archétypes primitifs dont l’absence a surgi avec cruauté ces derniers jours et sur lesquels les architectes seraient bien inspirés de plancher dès à présent.
Paul Landauer, Mai 2020