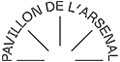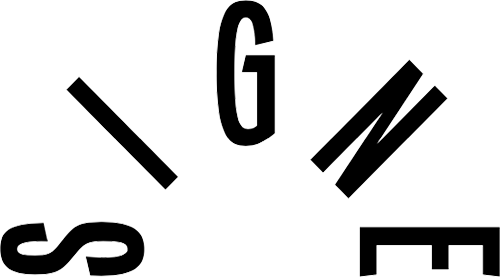« En l’an II ou III de la République, les plus beaux quartiers de Paris étaient déserts ; l’herbe poussait dans les rues comme sur un pré. Un des botanistes les plus distingués qu’ait eu la France, un membre de l’Académie des Sciences, L’Héritier, profita de cette circonstance [et] écrit une Flore de la Place Vendôme ». - J. Valot, 1884
Rapportée près d’un siècle plus tard par J. Valot, également botaniste et auteur d’un Essai sur la Flore du Pavé de Pairs, limité aux boulevards extérieurs ou catalogue des plantes qui croissent spontanément dans les rues et sur les quais, cette anecdote relève pourtant de la légende.
Et pourtant, on pourrait y croire.
Car depuis un mois et demi, et de chaque coin de la planète, il nous provient des images d’air pur et de ciel bleu, d’animaux sauvages traversant les rues. Partout on entend que la crise profiterait à l’environnement. À Paris ce sont des canards, à Créteil des hérons, des sangliers à New-York ou un jaguar à Calcutta, et nos réactions d’humains face au ballet des non-humains relèvent de l’émerveillement, de l’apaisement. Il y aurait des renards au Père-Lachaise, prière à ce propos, de ne pas les nourrir
La vie reprend le dessus, ça nous rassure.
Comme s’il existait une contrepartie positive à l’épidémie de COVID-19.
Comme si jusqu’alors, la vie s’était absentée de nos existences d’habitants des villes.
Si l’eau oxyde et réduit la roche, fragmentant ce que les pédologues nomment matériau parental en des morceaux plus petits, son pouvoir de destruction permet la vie terrestre.
L’humanité, elle, dégrade son milieu sans le rendre plus fertile. Elle arase et érode, désherbe et cure, recouvre, imperméabilise et gratte. Déjà J. Varlot rapportait que sous la IIIe République, des cortèges de techniciens de la voierie veillent à arracher d’entre les pavés la moindre trace de vert. Longtemps guidé par la vision hygiéniste, l’humain a détruit toute vie échappant à son contrôle.
En ville, il n’y a plus guère que dans les interstices, les anfractuosités de l’asphalte et du béton que la vie sauvage parvienne à se maintenir.
Autant d’écosystèmes, et donc de milieux, propices à une vie n’attendant que son moment pour jaillir.
Avant la crise, la gestion différenciée a diminué la pression s’exerçant sur ces milieux. Les promeneurs avertis ont fait l’expérience, parfois par le biais des sciences participatives, de cet ensauvagement à échelle variable. Pied de murs et d’arbres, micro-fissures dans l’asphalte des trottoirs, vastes friches et délaissés ont vu depuis l’application de la loi Labbé pousser ailanthus et buddleia, cymbalaires et fougères et parfois même des espèces moins compétitives et plus horticoles échappées des jardins d’ornement.
Autant de preuves de la validité du concept du jardin en mouvement, autant d’exemples en action du pouvoir des vagabondes chères à Gilles Clément et Francis Hallé.
L’espace d’un mois et demi, l’humanité s’est donc retirée. Marée basse sur la ville. Le sable découvert n’est pas désert. Il abrite la vie. Elle émerge timidement hors des interstices. Plus de piétons ni de voitures, plus de trottoirs lavés à haute pression : la poussière s’accumule, s’organise en petites couches de substrat nécessaire au développement de mousses, d’algues et d’adventices.
En théorie, la suite, bien connue, est déjà écrite. À ce stade premier de recolonisation en suivront d’autres, jusqu’au stade final, dit climacique. C’est la succession écologique, modélisation d’un processus naturel, celui de l’évolution d’un écosystème en une succession de stades. En bref (et c’est discutable), chaque milieu sauvage deviendrait sous nos latitudes tempérées une forêt mixte.
La ville sans l’humain constituerait donc le degré zéro de cette succession écologique.
C’est dans la réalisation de ces cycles longs que s’épanouit le génie naturel. Le pouvoir de résilience de la biodiversité, notion que l’humain comptable et gestionnaire a baptisé services écosystémiques, nécessite du temps pour se mettre en œuvre. L’immédiateté des bouleversements constitue donc l’une de ses plus grandes limites.
Quoique conceptuelles, ces notions devraient cependant nous guider, notamment dans l’aménagement de nos villes. Le paysage, en cela qu’il se trouve en prise directe avec le vivant, pourrait proposer une approche faisant cas du temps long, tendant vers la moindre intervention, vers un aménagement par soustraction.
Cette approche permettrait aux humains de découvrir la richesse d’un monde qui n’attend que notre absence pour s’épanouir.
Au-delà de la question des services écosystémiques, nous pourrions ainsi continuer de nous émerveiller face à la grande danse du vivant qui, pendant le confinement, n’a fait que commencer.
En théorie, si nous ne faisons rien, si nous humains, préservons l’espace public de notre présence, la ville redeviendra bientôt prairie, puis friche armée, puis forêt.
La ville au stade zéro de la succession écologique.
Baptiste Miremont, Avril 2020